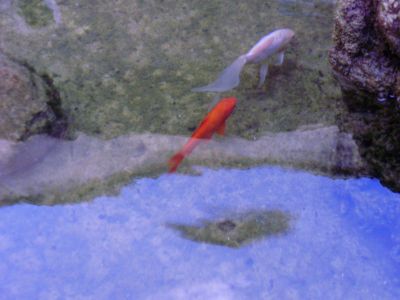29/10/2013
CETTE PARCELLE INEPUISABLE
Marie-Ange Sebasti nous offre un recueil pétillant et frais comme un verre de limonade. Pas de pesanteur dans ces textes, où l’enfance est convoquée à tous les étages. L’enfant du recueil, c’est le poème, celui qui pique de courtes mais violentes colères, qui trépigne d’impatience pour sortir. Un enfant turbulent qui démonte les lucarnes / et défie les étoiles / sans jamais grandir en sagesse. L’enfant, le poème, permet au regard de se perdre à l’horizon, de dialoguer avec les anges. Il est une invitation à un voyage aux quatre saisons des déserts ; les mots naviguent autour du monde, s’assoupissent au cours de longues escales, puis reviennent à quai, la peau hâlée. Marie-Ange Sebasti explore avec beaucoup de malice cette parcelle inépuisable qui permet une échappée belle, et de s’affranchir du gris des jours et des peurs du passé. Son recueil prend délibérément le parti du bonheur. J’exerce mes pinceaux / à rattraper la joie / sur la ligne de fuite. Retrouver son cœur d’enfant, c’est aussi ne pas se prendre au sérieux, conserver un brin de fantaisie et de légèreté. On ne se lasse pas de ces images où s’exerce l’imagination, ni de ces souvenirs du jardin du Palais-Royal où une nuée d’enfants migrateurs / virevoltait. Un beau recueil.
Marie-Ange Sebasti, Cette parcelle inépuisable, Jacques André éditeur, 2013
19:08 Publié dans Chroniques
02/10/2013
AU COEUR DE LA ROYA

Monastère de Saorge. Crédit photo : Paul Silici
Françoise Siri a écrit ce recueil au cours d’une résidence d’écriture dans le monastère de Saorge, petit village médiéval à flanc de colline des Alpes maritimes, au cœur de la Roya. Les premiers textes s’attachent à dépeindre la montagne qui porte le village, la roche, le pavé italien, à les rendre vivants. Les images convoquent les sens pour doter de vie le paysage : sur le rocher la verte agreli a le goût acidulé de l’enfance. L’église et le cloître sont dépeints : partout des mains / Des mains offertes des mains ouvertes, des anges et une croix. Les murs du couvent sont ornés de fresques à moitié effacées, d’un gros médaillon tendre comme un biscuit / Rose guimauve et vert anis ; les fresques sont en lambeaux, la peinture, délavée, effacée par les âges ou par la main de l’homme. Les personnages de ces fresques sont défigurés et ici, c’est la souffrance qui perce, La fresque saigne blanc. Plus loin sont évoquées les veuves du village, et c’est la mémoire qui resurgit, celle d’avant la guerre, avec les scènes de bal où les filles dansaient pour trouver un mari. Au cœur de la Roya a la saveur des biscuits d’antan au goût délicat et tendre, friables comme les vestiges du passé.
Françoise Siri, Au cœur de la Roya, Éditions Henry, 2013
10:08 Publié dans Chroniques
30/08/2013
JOUR

« Jour » se présente comme une succession de tableaux, fragments du point de vue ou du monologue intérieur d’un narrateur qui décrit ce qu’il voit, se souvient du passé, ou s’adresse intérieurement à la femme qui l’a quitté. C’est le même « Je » qui s’exprime, que ce soit pour évoquer un homme endormi sur le sol, la ville où se répand le bruit / sourd des quotidiens / mécaniques, ou pour revenir sur sa vie d’autrefois, sur le visage de la femme aimée, qui lui a échappé. La frontière entre le narrateur et les hommes sur lesquels il porte son regard est ténue, tant ils semblent aussi perdus, démunis et dénués de perspective les uns que les autres. Cette focalisation est un prétexte pour évoquer les corps empêchés, les vies frappés d’amnésie. Ce matin le ciel / ne s’ouvre pas / et la peur sourd / des murs. Pour le narrateur, l’ouverture, même sans issue, est dans le passé, sans cesse ressassé. Dans le souvenir des enfants d’Amérique des années trente dont les photographies ont hanté la vie d’écolier. « Jour », finalement, se termine par une échappée, sur le port où le vent fouette le visage. Je bois jusqu’à plus soif la lumière / du jour.
Jean-Jacques Marimbert, Jour, Éditions Les Carnets du dessert de lune, 2013
10:26 Publié dans Chroniques
26/01/2013
LE BLEU DES VEINES
Dans le titre perce déjà la notion de fragilité : la finesse et la blancheur de la peau laissant transparaître le bleu des veines. Louis Raoul écrit tout en délicatesse, à l’écoute de l’imperceptible solitude des êtres qu’il évoque. Ceux qui ne sortent plus / Habitent des maisons végétales / Ils n’ont plus de corps / Depuis longtemps / Il ne reste aux fenêtres / Qu’un visage de longues veilles / Noyé dans la vitre. Ces premiers vers portent à eux seuls le vide, la blancheur, le sentiment d’inexistence de ceux qui, restés derrière la vitre, n’ont que la désolation du paysage pour meubler leur solitude. Ce qui est évoqué ici, ce sont des vies qui ne sont remplies par rien, si ce n’est l’éternité d’une cigarette / À chaque aspiration […] et ces moments de rêverie / Où tout ne tient que par un fil / Bleu.L’imperceptible, c’est le vent derrière les arbres / Et ce froissement entendu […] l’odeur du pain grillé / Celui qu’il faut mâcher lentement / Pour croire un moment / Que ces pas dans la neige / Sont pour nous.Mais personne ne viendra. Louis Raoul, dont j’avais déjà rendu compte du recueil « Feuille de l’air » paru aux éditions de l’Atlantique, est à l’affût du tremblement léger de la vie, si léger que certains ne le perçoivent pas. L’impalpable solitude des mots.
Louis Raoul,Le bleu des veines, Citadel Road Editions, 2012
16:03 Publié dans Chroniques
25/10/2012
LA FACE DE L'ANIMAL

Il s’agit d’un livre dédié à la cause animale. Dans une longue préface émaillée de références, Matthieu Gosztola explique le sens de sa démarche. Mépris de l’homme pour l’animal, barbarie, indifférence. Comment chacun d’entre nous peut-il [...] faire preuve de la plus grande cruauté qui soit envers les animaux ? Tout simplement parce qu’il considère qu’étant autre, l’animal n’a pas de visage. Ce qui justifierait le fait que l’on peut mettre à mort un animal impunément. Les vers sont en apesanteur sur la page, posés ça-là, comme des plumes venant caresser un visage. Visage de l’animal personnifié par Matthieu Gosztola, lequel s’adresse à un être familier qu’il côtoie. Je suis pris à l’intérieur / Du conte de tes yeux. […] L’amour c’est quelqu’un qui est dans notre regard / Avec la joie de la lumière. […] Ton visage / A fait un enfant au silence. La douleur est là aussi, comme quelque chose d’aussi léger que la détresse au fond des yeux de l’animal. On parle sans hausser la voix de la douleur / Comme si le monde / Était ce qui vient d’être effleuré. Il s’agit d’un recueil d’une grande sensibilité.
Matthieu Gosztola, La face de l’animal, Éditions de l’Atlantique, 2012
09:38 Publié dans Chroniques
21/09/2012
TOMBÉ

L’écriture de Valérie Harkness se reconnaît par cette douceur dans la voix qui module des paysages de tendresse dans un décor atone blanc et froid, celui d’un hôpital où hommes et femmes se fondent dans les tissus, ailleurs, si loin de la vraie vie, de l’autre côté du mur. Valérie Harkness est à la recherche de ce supplément d’humanité qui va toucher juste la corde sensible de l’âme, empathie pour ces hommes et femmes relégués à l’arrière-plan de la vie par la maladie, la vieillesse. N’être les yeux de plus personne / N’être la vie de plus personne // Perdre le poids du souffle / le pousser par le tube / le faire couler par le sang / débarouler par des silences // Comme des morceaux invisibles de vie des autres / pendus à l’air de tous // N’être personne / plus. Valérie Harkness veut pousser plus loin la limite du regard, poser les yeux sur ceux que l’on ne voit pas, éprouver leur ressenti, car ils sont un peu d’elle-même, sans doute. Eux voudraient regarder par-dessus le mur, être avec la vie / des autres gens qui savent, mais ils s’aperçoivent qu’ils ne peuvent pas, car leurs yeux ne savent plus voir, ils sont restés derrière le mur. Jusqu’où va l’empathie ? Jusqu’au désir de changer de peau, d’être cet homme ou cette femme ? Toucher la peau qui m’appartient / qui colle / sans bouger / pendant que le corps me prend. Le « ils » laisse place au « je », le recueil se termine par un amalgame les cerveaux mêlés les uns aux autres comme des histoires / qui commencent tout le temps.
Valérie Harkness, Tombé, Éditions de l’Atlantique, 2011
09:38 Publié dans Chroniques
10/04/2012
DANS UN CORPS ZÉRO CONTOUR
Dans un corps zéro contour, l’enfance est. Qui se tient derrière la porte / et veut boire / et venir ?Chuchotis de l’été. Tilleul / poussière blanche de feuilles.Géométrie, pesanteur, apesanteur. Son poids nous regarde, / pivot furtif / extrait du ciel. Dans un corps zéro contour, il n’y a pas de circonférence. D’où le vertige. Toi non plus / en tant que centre de gravité / expulsant d’un coup / la colonne majeure. Pesanteur, apesanteur. L’odeur légère des tissus / s’enfonce.Ensuite, le vent soulève nos épaules d’au moins mille mètres. Vertige. Soudain, de la pelote / se dévide / une course en désordre.Écheveau des souvenirs ? mourir essaie mais non se hâte tel un fœtus / d’en reproduire le même son / non pas le creux tambour muet.Marie-Noëlle Agniau est solaire venue comme en automne. Le corps zéro contour est une flaque de poussière, le corps enfant déchu du corps maternel. Venir après pour combler un espace vacant. Chez Marie-Noëlle Agniau, il y a toujours ce poids et à la fois ce vide laissé par la perte d’un frère, jamais connu. Je dois bien arriver à tenir entre l’espace et moi la sorte de lutte qu’il faut mener. Se rapprocher du palpable, par l'acte symbolique. prénom auquel rien ne manque je t’apporte un yaourt. Revenir à l’état d’innocence. Le temps se presse en nous à l’état de peluche.
Marie-Noëlle Agniau, Dans un corps zéro contour, La Porte, 2012
12:55 Publié dans Chroniques
27/12/2011
LES JOURS OÚ ELSE

Ce livre est un vrai bijou. J’ai été transportée par ces récits imbriqués, dans lesquels s’entrelacent des contes, la langue bretonne intimement liée au français, se cousant au fil du récit. L’histoire d’Else se lit comme Le ravissement de Lol V. Stein de Marguerite Duras, sauf qu’il ne s’agit pas de la même histoire, ni des mêmes personnages. Simplement, la manière de raconter, la tournure des phrases, pleines de blancs, ou de mots décalés, opèrent comme un charme. Tout se passe en Bretagne, là où vit et où est née Lou Raoul ; il y a la mère, Solange, le père, et les trois petites. Puis vient Else, qui finalement imprime sa marque au récit. Else est née en février un matin dans une maison de bourg. Une naissance qui n’a pas provoqué d’enthousiasme particulier Une énième fille était née dans une famille qui en comptait déjà trois. Ce sont des bribes de vies, et l’on ne peut s’empêcher de penser que Lou Raoul parle un peu d’elle et un peu des siens dans ce livre. Personnages attachants, avec un univers poétique. Lorsque Solange, la mère d’Else, meurt, c’est le silence, plus de paroles pour parler des fleurs du jardin À présent le silence Non plus pour dire que les cognassiers du Japon commencent à fleurir depuis sept jours. Il y a aussi ce conte à portée philosophique où les villageois occupés à travailler ne savent plus quand est Noël, car l’argent a masqué le temps. C’est le conte de l’enfant bleu, celui qui comprend le langage des oiseaux, et le cœur des artisans occupés à travailler ne retrouve un peu de légèreté que lorsque l’enfant bleu est là. À la fin, Else parvient à changer l’âme noire de sa mère en âme blanche. Else a trouvé sur la tombe une bruyère fleurie déposée contenant une carte avec des mots qui l’attendaient Une autre fois c’est un rouge-gorge si près et qui chante.
Lou Raoul, Les jours où Else, Éditions Isabelle Sauvage, 2011
13:43 Publié dans Chroniques
23/04/2011
TE VISITE LE MONDE
Cet ouvrage s’organise en deux parties. Dans la première, l’émerveillement de l’enfant dans son ouverture au monde se mêle au mystère du lien qui l’unit à sa mère. tu souris rien qu’à voir ta mère bras tendus / te visite le monde par ce qui rouge ou bleu / n’a de vrai que ton arbre à peluches. Le langage du poème s’apparente à un apprentissage, les mots sont comme malhabiles. Ils sont des legos de couleur assemblés dans le désordre. Le poème est ici métaphore de l’univers de l’enfant, de son monde intérieur. Il suit sa progression dans la découverte de l’environnement. faut croire difficile partir te laisser aller / au-delà le corps le berceau et combien / nécessaire que tes bras la lumière. La difficulté qu’éprouve la mère à laisser sa fille quitter l’enveloppe protectrice s’efface finalement assez vite devant l’épanouissement de l’enfant dans ses premiers pas. Le champ s’élargit avec l’apparition du père dans l’univers, la naissance du caractère. La vie monte, éclate ; la parole émerge. infernale ta langue à toi / tu parles pas que des mots / du charabia en phrases entières. La deuxième partie aborde la pré-naissance et la naissance. ces mois de bruit de terre qui bat / commence très près très loin / quelque chose sous l’écorce. Ce qui palpite résonne, monte avec lenteur, prend le temps de grandir. sous quelle poussée tes doits retiennent / le si plein de terre pendant déluge / flotte berceau avant monde. Le titre du recueil résume à lui seul ces quelques vers : t’émerveilles face au monde / déroules pétales toutes ailes dehors / n’en finis plus de fleurir.
Cécile Guivarch, Te visite le monde, Les carnets du dessert de lune, 2009
09:41 Publié dans Chroniques
07/06/2010
ON NE DISCUTE PAS L'INFINI
Le présent recueil explore la finitude du corps, vécue dans la douleur ; corps assailli par les monstres, peut-être marins, avec lesquels il se heurte ; les nus, les échardes / dans les mains / progressent / sur la plaine ; […] les articulations se figent / les cartilages s’amincissent. Les monstres peuvent être ces charniers du monde sur lesquels la narratrice ferme les yeux, ou encore l’obscurantisme qui chavire dans l’effroi / des oiseaux nocturnes. La mort rôde : les guerres / se poursuivent / je suis / les méandres / du vent / il ne faut pas / me faire confiance. Et pourtant, de façon inattendue, surgit la lumière : jours de retour / les lèvres se portent / rouge vif / à la gare / maritime / le bateau pour la citadelle / est le même / qu’il y a cinq ans / je grelotte fin / dans mon pull. C’est là qu’intervient l’infini, lorsque le matin / est émerveillement / dans la virginité des trembles, et lorsque la clarté est façonnée par la patience de l’écriture : mais moi / je résiste / je façonne de la lumière / entre mes doigts. Ainsi le soleil s’infiltre entre les lattes du doute. Joie / au sang ancrée / quand tu / approches la main / du / rivage / il y ferait / bon vivre / sans le bruit / des chars. L’infini semble naître de la douleur même, lorsque celle-ci s’apaise, et que l’écriture / livrée au vent / recueill[e] / les étincelles. Alors le corps prolonge ses finitudes. L’eau / trouble / des jours instaure toujours le doute, de nouveau la mer se lève, les mouettes s’affolent, et pourtant c’est une vie de / vouloir vif / c’est une vie / de / voyages / in- / finis / naître / n’est pas / vain.
Emmanuelle Le Cam, On ne discute pas l’infini, Gros Textes, 2010
18:43 Publié dans Chroniques